|
Thèsez-vous?, c'est une expérience de rédaction partagée avec des étudiant.e.s issu.e.s d'une diversité de disciplines et d'universités à travers le Québec. C'est donc un plaisir de vous présenter, ici et là, des portraits des étudiant.e.s qui se joignent à nous lors d'une retraite, dans l'idée de mettre en valeur leur implication et leurs recherches. 1) En quelques mots, sur quoi porte votre projet de recherche? Ma thèse de doctorat en psychologie porte sur les impacts d’une danse-thérapie groupale sur les perturbations de l’image corporelle (distorsion et insatisfaction de l’image corporelle, recherche de minceur) et de l’intéroception (déficits intéroceptifs – difficulté à identifier les sensations physiologiques et les émotions) d’adolescentes hospitalisées pour un trouble alimentaire. 2) Pourquoi participer à Thèsez-vous? Pour profiter d’un contexte propice à la rédaction, développer de bonnes stratégies de travail et partager avec d’autres étudiants le vécu parfois tumultueux, parfois épanouissant qu’amène la rédaction d’une thèse. 3) Selon vous, quel est le plus gros défi de la rédaction académique pour un étudiant? Maintenir sa motivation tout au long du processus, malgré les embûches qui se présentent et l’ampleur de la tâche à accomplir. Pour en savoir plus sur la thèse d'Élysa Côté-Séguin...
0 Commentaires
Lors de la 8e édition des retraites Thèsez-vous? qui se déroulera au Manoir d'Youville du 2 au 4 septembre 2016, Aurélien Fievez sera des nôtres pour animer un atelier sur la reconnaissance vocale comme outil de rédaction universitaire. Ça promet! Résumé La rédaction universitaire proprement dite est parfois longue, complexe et surtout exigeante. Afin de rendre le texte produit de qualité, la rédaction demande une concentration importante et un travail linguistique abouti de la part du chercheur. Pour ce faire, différents outils sont à notre disposition, tel que la reconnaissance vocale. Afin de comprendre son utilisation et sa pertinence, plusieurs questions émergent : Quelle est la place de la reconnaissance vocale dans le panel des outils disponibles ? Comment celle-ci peut-elle favoriser la rédaction d’un document scientifique ? Quelles sont ses limites ? Quelles sont les parties du document à privilégier ? Comment les utiliser à bon escient ? C’est à l’ensemble de ces questions que cette présentation tentera de répondre afin d’apporter un éclairage sur cette pratique de rédaction novatrice. Aurélien Fiévez est titulaire d’un doctorat en sciences de l’éducation de l’Université de Montréal avec une spécialisation en intégration des technologies de l’information et de la communication (TIC), en psychopédagogie et en formation des maîtres. Il est chercheur régulier au Centre de Recherche interuniversitaire pour la Formation et la Profession enseignante (CRIFPE) et à la Chaire de recherche du Canada sur les TIC et l’éducation où il coordonne différents projets et évènements scientifiques. En parallèle, il est Expert scientifique au service du numérique éducatif à la Fédération Wallonie-Bruxelles où il s’occupe du pilotage numérique du système éducatif. Ses intérêts de recherche se centrent sur l’intégration des TIC en éducation, les modèles d’intégration, la formation enseignante et dans d’autres domaines liés aux sciences de l’éducation.
Il reste encore quelques places disponibles, inscrivez-vous dès maintenant!
Ce n'est pas une formule magique, mais un petit mode d’emploi pour l’organisation d’un #ThèsezVousMaison, chez soi, au chalet, chez vos parents, dans la cabane du petit cousin réquisitionnée pour la cause: votre mémoire, votre thèse, un article qui tarde, une demande de bourse qui presse, la huitième version (finale!) de ce rapport d'activité. 1) Planifiez un horaire rigide, que vous respecterez à la minute près C’est une façon concrète de s’engager dans la rédaction, en découpant la journée en cases horaires déterminées à l’avance, chacune associée à des objectifs de rédaction précis. L’idée est de diviser votre journée en périodes réalistes plutôt que d’inscrire à votre agenda RÉDACTION pour la journée entière, comme si ça allait se dérouler pendant 12 heures sans arrêt, comme si les majuscules y changeaient quelque chose... Bonus Pourquoi ne pas s’inspirer de l’horaire des retraites Thèsez-vous? qui, tranquillement, semble faire ses preuves! Remplacez simplement les ateliers par des discusions thématiques entre étudiant.e.s et les activités en plein air par votre loisir préféré. 2) Prévoyez vos pauses et ce qu’elles impliquent en termes de ravitaillement pour le corps et l'esprit La veille de votre journée de rédaction, planifiez à l’avance vos repas et collations. L’idée est de ne pas perdre de précieux temps de rédaction et, surtout, ne pas utiliser la nourriture comme excuse à la procrastination. De même, allouez-vous des pauses réelles qui n’impliquent pas d’écran (dans le doute, précisons que le cellulaire EST un écran ;) ). Bouger reste idéal. Sortez dehors, faites votre lavage avec énergie, trouvez-vous une marelle! Cela dit, il s'agit d'une pause et il faut s’y remettre ensuite. Pour faciliter la transition sans trop vous poser de questions, fixez-vous un temps de pause et, plus essentiellement, respectez-le! Bonus L’heure qui suit le diner semble être LE moment pour se dégourdir, retrouver de l'énergie et ne pas sombrer dans la démotivation de l’après-midi, caractérisée par des images persistantes de sieste ou d’apéro en terrasse. Offrez-vous une heure complète de pause, sans culpabilité pour éviter de perdre une heure à fixer l'écran sans produire quoi que ce soit de significatif. 3) Organisez votre cadre de rédaction en conséquence Votre cadre de rédaction doit favoriser la concentration. Pensez au son (des bouchons? des écouteurs?), à la lumière (suffisante et naturelle de préférence), à l’ergonomie (pourquoi ne pas vous installer pour rédiger une partie de la journée debout?), à la disponibilité des outils (livres, articles, bloc notes sous la main pour inscrire les idées à ne pas oublier, mais qui n'ont rien à voir avec votre rédaction). Si vous rédigez dans un espace où il est possible de vous déranger (au travail, auprès de votre famille, dans un espace public), assurez-vous pour que votre isolement symbolique est clair, annoncé et respecté (ceux, celles qui vous aiment comprendront). Bonus Au moment où vous vous dites « J’ai besoin d’Internet pour aller chercher des articles », doutez de vous-même. Il sera toujours préférable de se déconnecter, que ce soit via votre ordinateur ou votre cellulaire (Et le mode vibration n'est pas synonyme de déconnexion ;) ). C’est ardu, certes, mais très payant au final. Offrez-vous la quiétude d'un "blitz" de rédaction sans interruption. 4) Trouvez-vous des âmes sœurs (réelles ou virtuelles) L’une des leçons tirées de l’expérience des retraites Thèsez-vous? est l’effet positif du groupe sur la motivation. N'hésitez pas à vous allier d’étudiant.e.s qui vivent des défis similaires pour rédiger en chœur. Il apparait essentiel de déconstruire cette représentation de la rédaction qui se veut inévitablement souffrante et solitaire. Au contraire, la solidarité silencieuse qui s’installe lorsqu’on rédige à plusieurs supporte et pousse à persévérer lorsque la motivation s’effrite. Bonus Vous avez déjà participé à une activité Thèsez-vous, contactez d’ancien.ne.s participant.e.s pour des périodes hebdomadaires et collectives de rédaction non négociables. L'idée est de profiter du fait qu'il est souvent plus facile de respecter un engagement envers ses pairs qu’envers soi-même. Enfin, s’il est douloureux de rédiger en été, ce serait malhonnête de ne pas en reconnaitre ses réels avantages: On a très rarement froid aux extrémités, on peut rédiger dehors, on débute généralement après que le soleil se lève et termine avant qu’il ne se couche et personne ne semble répondre à ses courriels, invalidant par le fait même la façon par excellence de procrastiner. Autrement dit, pause de "je débute dès que j'ai répondu à mes courriels". En espérant que vous saurez profiter de ces quelques astuces, bonne rédaction et n'hésitez pas à nous envoyer vos photos #ThèsezVousMaison. On est curieux, curieuse, et ça motive les troupes! Billet rédigé par Sara Mathieu-C., Co-fondatrice de Thèsez-vous? .
Mise à jour en août 2023. |
Envie de contribuer au blogue ?N'hésitez pas à nous contacter, ainsi qu'à nous soumettre vos idées sur les enjeux de la rédaction et de la vie académique! Archives
Septembre 2023
Thèmes
Tous
|
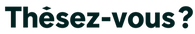

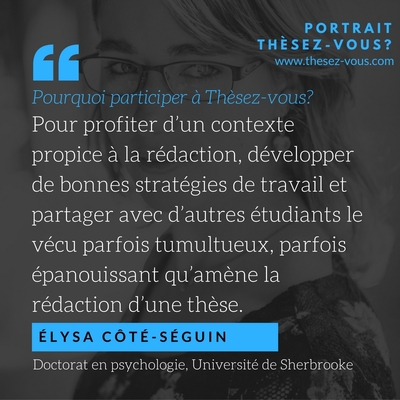
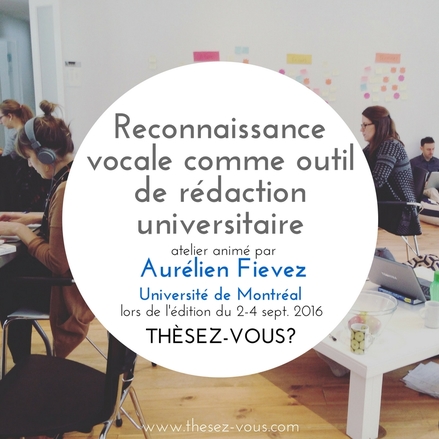


 Flux RSS
Flux RSS