|
Pour plusieurs, la rédaction d’un mémoire ou d’une thèse implique de longues périodes de solitude. Cet isolement est partagé, mais n’est pas vécu de façon similaire pour tous et toutes. Sans surprise, son intensité et ses conséquences se révèlent plus importantes chez les étudiant.e.s susceptibles de vivre des inégalités sociales. Comme le soulignais Alexie Labelle dans Le Devoir en juin dernier : l’université fait naufrage pour certains plus que d’autres et les inégalités (de genre, de sexualité, de race, de capacités, etc.) teintent grandement le parcours des étudiant.e.s aux cycles supérieurs . D'autres recherches comme celles de Janta et al. (2014) et Lovitts (2011) ont permis de souligner la rareté, voire l'absence, de relations signifiantes durant la période de rédaction, un manque qui agit comme un facteur de risque important lorsqu’il est question de prolongation et d’abandon. Parallèlement, on observe peu de ressources et un vide structurel quant aux occasions de permettre, au minimum, le partage de cette expérience difficile au fil du parcours académique. À l’inverse, l’intégration sociale au sein de la communauté académique peut jouer un rôle majeur sur la persévérance. Cela permet de comprendre et de vivre les codes de la communauté, d’accéder à des connaissances tacites et des ressources plus ou moins officialisées. Gardner (2010) va jusqu’à soutenir que ce processus de socialisation et d’intégration est le déterminant principal de la persévérance aux cycles supérieurs. À la lecture de ces écrits et en accordant une attention particulière aux témoignages des quelques étudiant.e.s en situation d’immigration ou d’échange qui ont participé aux retraites de rédaction Thèsez-vous, nous en sommes venues à la conclusion que nous avions le potentiel de faire une différence. Au-delà des vœux pieux, nous avons décidé d’en faire une priorité pour 2018-19 : Rendre nos services plus connus et accessibles aux étudiant.e.s qui font face aux nombreux défis de l’intégration dans une nouvelle communauté académique. Et notre partenariat avec le Programme canadien de bourses de la Francophonie en est une manifestation concrète. Vendredi dernier, Thèsez-vous a donc signé une entente avec l’équipe du Programme canadien de bourses de la Francophonie (PCBF). Grace à cette dernière, tous les boursiers et toutes les boursières du PCBF deviendront automatiquement membres de Thèsez-vous. De plus, le PCBF soutiendra les étudiant.e.s à la maitrise ou au doctorat pour qu’ils, elles puissent s’inscrire gratuitement aux retraites de rédaction. Le saviez-vous? Dans le cadre du Programme canadien de bourses de la Francophonie, le Québec reçoit chaque année des ressortissants de 37 pays membres de la Francophonie qui viennent poursuivre un diplôme aux cycles supérieurs. Il s’agit d’un parcours très exigeant et Thèsez-vous est particulièrement fier de pouvoir y contribuer. Que ce soit au futur Espace Thèsez-vous ou lors de nos retraites de rédaction, nos activités s’enrichissent par la participation d’étudiant.e.s dont les profils, les expériences et les expertises sont diversifiées. Nous avons vraiment hâte d’y retrouver les boursiers et boursières du PCBF !
0 Commentaires
|
Envie de contribuer au blogue ?N'hésitez pas à nous contacter, ainsi qu'à nous soumettre vos idées sur les enjeux de la rédaction et de la vie académique! Archives
Septembre 2023
Thèmes
Tous
|
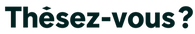


 Flux RSS
Flux RSS