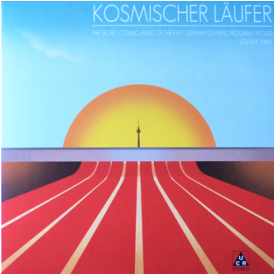 Tiré de: www.kosmischerlaufer.com Tiré de: www.kosmischerlaufer.com Vous cherchez un environnement auditif idéal à la rédaction? Kosmischer Laufer a récemment piqué la curiosité de l'équipe de Thèsez-vous! Signifiant "Courreur cosmique", Kosmischer Läufer reprend les sonorités provenant du programme musical allemand des olympiques 1972-1983. Ce programme avait comme principal objectif d'élaborer une ambiance musicale suscitant la concentration et le rendement chez les athlètes allemands. Le principe qui se cache sous cette proposition musicale est qu'une sonorité répétitive, voire hypnotique, favorise le "focus" pendant des périodes de temps prolongée. Un pensez-y bien au moment où vous entamerez votre prochaine séance de rédaction... Dans tous les cas, cette découverte musicale semble avoir été composée juste pour nous, thésard.e.s professionnel.le.s! Et vous, est-ce que la musique fait partie de vos habitudes de rédaction? Avez-vous des suggestions musicales à partager avec la communauté Thèsez-vous? Pour écouter Kosmischer Läufer: kosmischerlaufer.bandcamp.com/music Pour en savoir plus (en anglais): www.kosmischerlaufer.com Billet rédigé par Émilie Tremblay-Wragg et Sara Mathieu-C., Co-fondatrices de Thèsez-vous?, en collaboration avec Marc-André Proulx!
0 Commentaires
Voici un aperçu des invité.e.s qui se joindront à nous lors de la retraite Thèsez-vous? du 15 au 17 mars 2016. ATELIER 1 : Cet atelier présente des trucs et astuces pour faciliter la rédaction d'un paragraphe ou d'un chapitre de mémoire ou de thèse. En plus de présenter des principes généraux liés à la rédaction scientifique, le conférencier accompagnera sa présentation d'exemples concrets (phrases, liaisons, connecteurs idéaux) pour appuyer ses idées. Animé par Simon Collin, M.Sc.,Ph.D., professeur en didactique du français langue seconde à la Faculté des sciences de l’éducation de l’Université du Québec à Montréal (UQAM). Il est également directeur du Centre de recherche interuniversitaire sur la formation et la profession enseignante - Université du Québec (CRIFPE-UQ). Ses travaux de recherche portent sur le rapport entre les technologies, la culture et la société en éducation. Ses expériences de rédaction liées à son travail de chercheur l'ont amené à rédiger plusieurs écrits scientifiques dans les dernières années, ce qui guidera le contenu de son atelier. ATELIER 2 : Lors de l'atelier offert par Sylvie Labelle, les participants auront l'occasion de réfléchir à la façon dont ils établissent leurs priorités dans le contexte où la rédaction d'un mémoire ou d'une thèse s'étend sur plusieurs mois. La conférencière abordera les défis propres à la gestion de temps et des outils pour y faire face. Animé par Sylvie Labelle, PCC (ICF), expérimentée en coaching intra et interpersonnel, en coaching de carrière, d'équipe et de gestion. Elle détient une maitrise en administration des affaires (HEC) et un doctorat en leadership créatif (UdeM), en plus d'un certificat en coaching professionnel et personnel (Concordia). Elle est présidente de CFI Syllab inc. et associés, un cabinet-conseil qui se spécialise dans le coaching en leadership, en innovation et en développement créatif. En plus des deux ateliers, Élise L.-LeMoyne et Simon Collin offriront un soutien individualisé lors de la deuxième journée de la retraite. Les participant.e.s pourront aborder de questionnements spécifiques lors d'une rencontre individuelle d'une vingtaine de minutes, sur rendez-vous. Élise L-LeMoyne, Ph.D., est chercheure post-doctorale au Tech3Lab (HEC) et nouvellement membre de l'équipe organisatrice des retraites Thèsez-vous?.Depuis le dépôt de sa thèse sur les Effets de l'activité physique durant la grossesse sur le cerveau de la mère et de l'enfant, elle contribue à des projets de recherche à la croisée des neurosciences et des sciences de la gestion, notamment sur le potentiel du bureau actif sur la mémoire et la performance. Billet rédigé par Sara Mathieu-C., Co-fondatrice de Thèsez-vous?
Candidate au doctorat en psychopédagogie à l'Université de Montréal Dans le cadre de la 3e édition de "Thèsez-vous?", une Bourse Érudit était offerte à un ou une étudiante inscrite à un programme en sciences humaines ou sociales. Pour obtenir cette bourse, les candidat.e.s étaient invité.e.s à soumettre un court texte inspiré du thème À l'ère de Twitter et de ses 140 caractères, pourquoi se lancer dans la rédaction d'un mémoire ou d'une thèse? Nous sommes heureux de vous présenter Marie Jocya Paviel qui obtient la 2e Bourse Érudit et de publier son billet sur le Blogue Thèsez-vous, ainsi que sur le Blogue Érudit.  À l’aube du XXIème siècle, notre société n’a jamais été si convaincue par l’idée que « Monsieur, Madame Tout le Monde » a un accès infini à de nombreux savoirs et connaissances. Plus encore, nous ne doutons plus que tout un chacun participe à la construction de ces savoirs, notamment grâce à l’avènement des réseaux sociaux, un des plus grands bouleversements depuis la révolution industrielle. Peut-on pour autant qualifier cette révolution d’intellectuelle ? Les sociologues et les philosophes ont fort à discuter sur la question. Dans ce contexte, une seconde question se pose : Quelle place doit-on accorder aux mécanismes de construction et de transmission des connaissances quand il ne suffit que d’un « clic » pour rédiger ou transférer une information? Les connaissances sont désormais compilées, voire marchandées, alors que des réseaux sociaux comme Twitter rende un auteur incontournable dès lors qu’il cumule plus de 100 followers pour la modique somme de 140 caractères. Si autrefois, la connaissance appartenait aux seuls érudits, elle devient aujourd’hui accessible, mais souvent réduite telle une peau de chagrin… revers d’une médaille peu reluisante d’une société dite (sur)informée. Dès lors, se lancer dans la rédaction d’un mémoire, d’une thèse, d’un article littéraire, philosophique ou scientifique s’apparente à un acte de résistance face à cette paupérisation du savoir. Explorer l’inexploré, comprendre les phénomènes qui nous entourent, remettre en question, douter, réfuter des faits établis comme le préconisait l’illustre philosophe des sciences Karl Popper, tout cela nécessite un cadre spatiotemporel qui dépasse largement celui des réseaux sociaux. Rédiger est un acte créateur et créatif, que toute personne intéressée à comprendre le monde peut réaliser. Néanmoins, participer à la construction des connaissances est un processus qui prend du temps, plus qu’un simple « clic ». Et surtout, il implique une réflexion et un jugement critique. Non pas que les réseaux sociaux soient dénués d’intérêt - accordons-leur le mérite de repousser les frontières et de connecter notre monde - mais force est de reconnaitre qu’ils alimentent une certaine uniformisation des savoirs. Cela va à l’encontre de l’idée de Progrès telle que portée par les philosophes des Lumières qui rappellent la nécessité d'adopter une approche réflexive afin de mieux comprendre et appréhender le monde qui nous entoure. Alors à nos crayons, à nos claviers, et « thèsons-nous » !  Après une première carrière dans un champ lié aux télécommunications au sein d’une compagnie privée, MARIE JOCYA PAVIEL réalise en 2008 un retour aux études. Elle obtient un baccalauréat en psychologie, puis un DESS en intervention comportementale auprès des personnes ayant un trouble du spectre de l’autisme (TSA). Elle poursuit ensuite ses études à la maitrise en éducation à l’Université du Québec à Montréal (UQAM). Son mémoire porte sur le sentiment d’efficacité personnelle des enseignants du primaire qui oeuvrent auprès des élèves ayant un TSA. Elle souhaite ainsi soutenir la pratique enseignante auprès de cette clientèle et contribuer à l’avancement des connaissances en ce sens. Parallèlement, Marie Jocya Paviel est chargée de cours à la faculté des sciences de l’éducation de l’UQAM. Elle est également maman de deux jeunes adultes qui poursuivent actuellement leurs études au collégial. Il était une fois une variable x qui était associée à une variable y, mais seulement aux niveaux élevés d’une variable z. Vous pensez que c’est ridicule? Pensez-y deux fois Il y a toutes sortes de bonnes raisons pour planifier un article scientifique avant de commencer à l’écrire. L’une d’entre elles est qu’un bon article s’organise autour d’un fil narratif bien choisi. Un article captivant contiendra toujours une histoire qui relie les éléments, leur donne un ordre et en renforce la signification. Sans histoire, un article n’est une collection de résumés d’autres articles suivis d’une avalanche d’analyses: il manque de cohérence et il est si ennuyeux qu’il va faire augmenter le prix du café. Un bon article, qui non seulement rapporte un bon projet de recherche mais est agréable à lire, partage bien des points avec une histoire. Un article scientifique traite d’un problème, alors qu’une histoire contient une intrigue qui tourne autour d’un problème: une question irrésolue, un conflit, un obstacle. Dans sa forme la plus commune, un article scientifique contient une question irrésolue et parfois aussi, pour corser l’intrigue, un conflit d’approches théoriques ou encore des obstacles méthodologiques à surmonter. Bref, vous avez dans un article scientifique tous les éléments requis pour raconter une histoire. Par exemple:
Histoire (intrigue = conflit d’approches): La littérature montre que la privation maternelle est associée à des comportements sociaux malhabiles chez les jeunes rhésus. Toutefois, notant que le protocole expérimental classique leur impose un stress plus important que ce qu’ils rencontreraient à l’état sauvage, les auteurs décident de reposer la question avec un nouveau protocole . Vous voyez? L’histoire vous dicte comment organiser la revue de littérature pour mener aux questions et hypothèses. Alors comme disait toujours mon superviseur de postdoc quand je lui présentais des résultats, quelle est votre histoire? Sources pour ce billet: Day, R. et Gastel, B. (2011). How to Write and Publish a Scientific Paper, Seventh Edition, Santa Barbara, CA: Greenwood. Sword, H. (2012). Stylish Academic Writing. Cambridge, MA: Harvard University Press. Billet rédigé par Nadine Forget-Dubois, blogueuse invitée, passionnée de la rédaction scientifique.
Nous vous invitons à consulter son blogue, laplumescientifique.com, fort utile si vous souhaitez vous lancer dans l'écriture d'un premier article. Thèsez-vous?, c'est une expérience de rédaction partagée avec des étudiant.e.s issu.e.s d'une diversité de disciplines et d'universités à travers le Québec. C'est donc un plaisir de vous présenter, ici et là, des portraits des étudiant.e.s qui se joignent à nous lors d'une retraite, dans l'idée de mettre en valeur leur implication et leurs recherches.  Marie-France Goyer Étudiante au doctorat en sexologie Université du Québec à Montréal Retraite de juin 2015 et de décembre 2015 1)En quelques mots, sur quoi porte votre projet de recherche?
En continuité avec mon mémoire de maitrise, mon projet de thèse porte sur les trajectoires relationnelles des personnes en relation polyamoureuse. Plus précisément, je m’intéresse aux besoins que les personnes cherchent à combler dans leurs relations en émettant l’hypothèse que les besoins que les partenaires cherchent à combler influencent la configuration relationnelle qu’ils privilégient (relation mono/polyamoureuse). Aussi, comme le polyamour se heurte à un contexte social mononormatif, je cherche à décrire les défis rencontrés par les partenaires engagés dans ces relations ainsi que les stratégies mises en place pour répondre à ces défis. Finalement, je souhaite documenter le parcours relationnel de personnes en relation polyamoureuse de façon à identifier les trajectoires qui s’en dégagent. 2)Pourquoi participer à Thèsez-vous? D’abord pour réserver trois journées complètes consécutives à la rédaction en se libérant des distractions quotidiennes, mais aussi et surtout parce que la formule de la retraite (horaire fixe, activités extérieures, ateliers, etc.) permet d’identifier les conditions favorisant la rédaction. En identifiant ces conditions favorables, il est ensuite possible de les reproduire à la maison. 3)Selon vous, quel est le plus gros défi de la rédaction académique pour une étudiante? Pour moi, le plus grand défi de la rédaction académique consiste à dépasser l’anxiété qu’elle suscite. Complexe de l’imposteur, perfectionnisme, volonté (que dis-je, obsession!) de pondre de belles phrases dès le premier coup de crayon… Ces pensées sont toutes autant d’ennemis qui favorisent le syndrome de la page blanche. Je dirais que le plus grand défi est d'apprendre à tolérer l’imperfection.  Avec 4 enfants, je n'ai eu d'autres choix que de devenir la reine de la conciliation travail-étude-famille. Et même s'il s'agit souvent d'un casse-tête, cette réalité est devenue une source d'énergie et de fierté avec le temps. D'ailleurs, trop souvent, on n'entend que les difficultés de la réalité des parents-étudiants. Je vous propose donc, cette fois-ci, d'y dénicher un peu de positif! Avant mon admission au doctorat, je travaillais comme enseignante dans une école primaire. Je devais alors prendre congé pour amener mes enfants à des rendez-vous de toutes sortes, je ne pouvais commencer à préparer un repas santé avant 18h00, et ce, en prenant soin de faire étudier les mots de vocabulaire entre deux carottes à éplucher. Et lorsque je pouvais enfin m'assoir en silence, une pile de lavage se pointait le bout du nez! Depuis que je suis au doctorat, ces tâches n'ont pas disparu par magie: la pile de lavage ne semble jamais descendre et la liste des mots de vocabulaire s'allonge d'une année à l'autre. Je peux toutefois accomplir nombreuses tâches au moment souhaité, entre deux paragraphes, une liberté que m’offrent les études supérieures dans la gestion de ma vie familiale. Et ça, ça n'a pas de prix! Je vous mentirais sans doute si j’omettais de dire que ma vie est très occupée et que la fatigue se fait souvent sentir. Ce qui est le plus difficile, c’est la culpabilité. Je me sens toujours coupable lorsque je dois rédiger le dimanche, alors que le reste de la famille s’amuse. Je relativise alors, en me rappelant que la plupart du temps, je passe des moments de qualité avec les enfants et que la rédaction d’une thèse ne se fait pas sans compromis. Cela dit, pour se sentir bien dans cette conciliation travail-étude-famille, il est nécessaire d'être réaliste et souple dans les délais qu’on se fixe en matière de rédaction. Me sentir motivée fait toute la différence. Dans la mesure du possible, je tente donc de prioriser des projets selon mes intérêts et selon mes affinités avec l'équipe de travail. Je dois aussi reconnaitre la présence d'un partenaire de vie et d'une famille très impliquée, qui m’appuie dans mes choix et qui s’occupe de la marmaille lorsque je suis en quête de savoir! Se sentir comprise et soutenue, du côté du boulot comme de la famille, m'apparait essentiel pour rester motivée. Enfin, je constate que, si je suis souvent débordée à force de vouloir faire tout de dont j'ai envie, il en ressort un bel équilibre intérieur. Les études me permettent d’avoir une activité intellectuelle qui m’apporte beaucoup et qui contribue à faire de moi une meilleure mère. C'est un joli casse-tête, qui me convient parfaitement! Signée, une maman aux mille et une responsabilités… Billet rédigé par Émilie Tremblay-Wragg., Co-fondatrice de Thèsez-vous? Candidate au doctorat en sciences de l'éducation à l'Université du Québec à Montréal. |
Envie de contribuer au blogue ?N'hésitez pas à nous contacter, ainsi qu'à nous soumettre vos idées sur les enjeux de la rédaction et de la vie académique! Archives
Septembre 2023
Thèmes
Tous
|
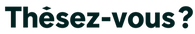
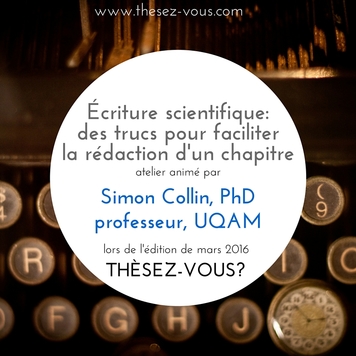
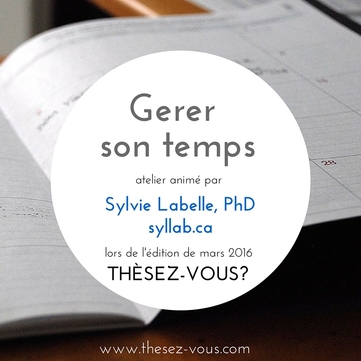
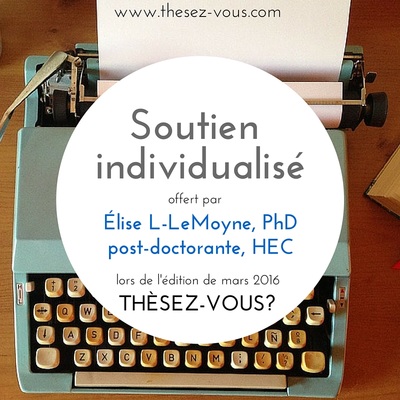
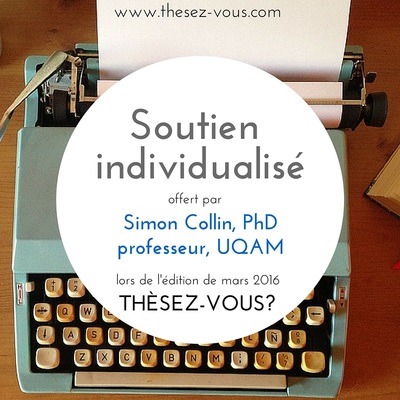
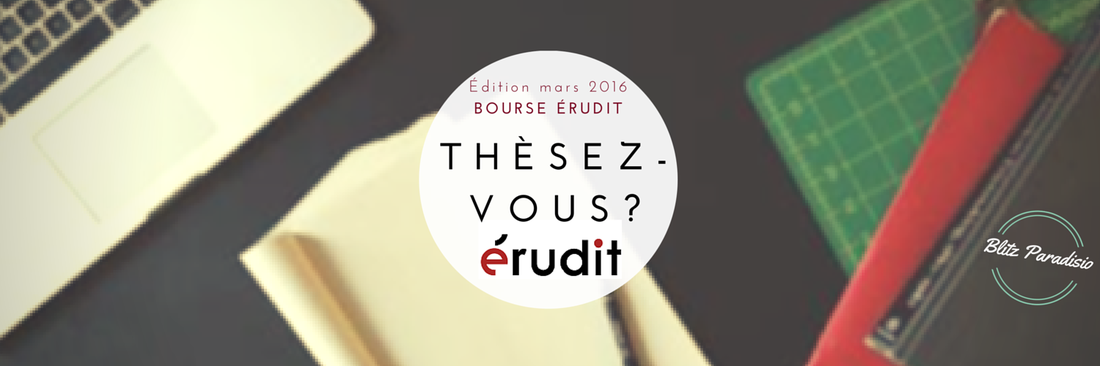
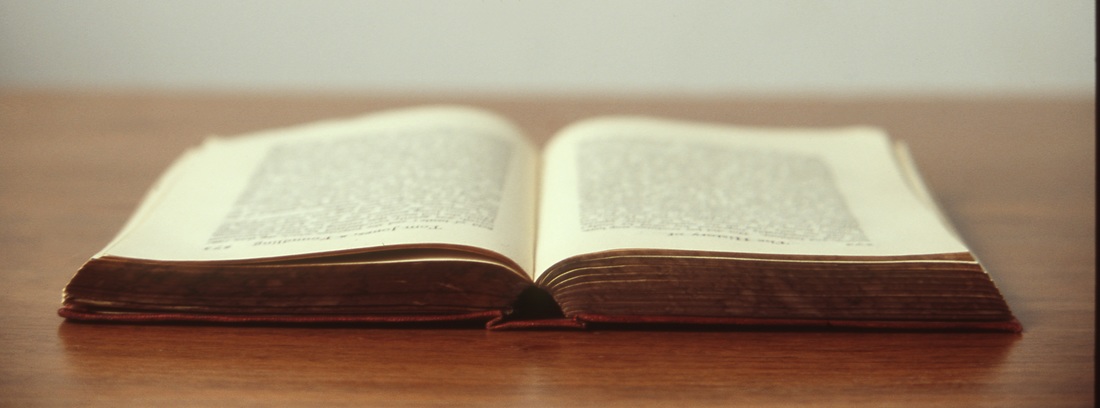
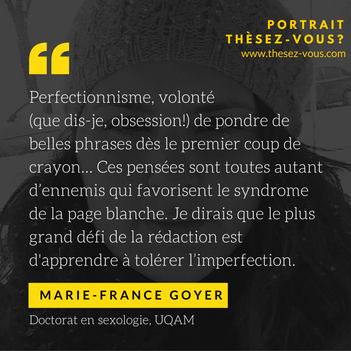
 Flux RSS
Flux RSS