|
Des participant.e.s rédigent avant, pendant, après les retraites Thèsez-vous?. La plupart du temps, c'est leur mémoire ou leur thèse qui prend forme. Mais parfois, d'autres écrits émergent, plus réflexifs et créatifs. C'est un plaisir de les partager sur notre blogue, comme une façon de nourrir la réflexion entourant la démarche et l'identité des membres d'une communauté académique plutôt éclatée. J’ai toujours cru que je ne faisais partie d’aucune minorité. Femme blanche occidentale, francophone, brune, taille et poids moyens. Je parle anglais et espagnol couramment, j’ai beaucoup voyagé, je fais des études supérieures, je travaille dans une galerie d’art contemporain, mais en communication. Pourtant, en ce 16 avril 2016, au bord d’un lac à Jouvence, je réalise que je me suis trompée. À commencer par mon domaine d’études, je fais ma maîtrise en langue et littérature françaises option recherche-création à McGill. J’étudie à McGill depuis bientôt un an en ayant toujours aimé le côté microcosme de cette université bien particulière qui ne « fit » pas avec le reste de la ville, de la province. Une province qui lutte pour l’indépendance du Québec, pour le respect de la langue française. Moi, j’étudie la langue française, mais dans une université anglophone. Je suis un spécimen étrange et francophone sur un campus international et anglophone. Je suis une étudiante internationale, aussi, mais je suis française. À l’intérieur de mon département, on pourrait penser que je me sente à ma place. Or, j’étudie en recherche-création. Soixante-dix pages sur cent de mon mémoire seront en création littéraire. Seulement trente pages de critique, trente pages théoriques, scientifiques, emploieront le langage universitaire. Le reste ? Libre à moi. Tellement libre que je me retrouve seule – avec mon directeur de maîtrise – sans cadre, ou si peu. En ce 16 avril 2016, on m’a posé la question des attentes et de la culture du milieu. C’est simple, on attend de moi que je sois capable de lire, de réfléchir, d’analyser et d’assimiler des concepts écrits et inventés par d’autres. On attend de moi que je « suive le troupeau », que je cite les bonnes personnes au bon endroit. On attend de moi un travail « digne du cycle supérieur ». Bien que réalisable sur mes trente pages de critique, aucun de ces critères n’est compatible avec mes soixante-dix pages de création. Aucune des attentes du « milieu » n’a de sens avec les deux tiers de mon mémoire. Comme si cela ne suffisait pas, j’étudie, je lis, j’écris, je réfléchis et je me questionne sur la place des femmes dans notre société. Je m’intéresse à leurs rôles, l’évolution de ces rôles, à leurs voix, à la portée de ces voix-là. Tout à coup, je réalise que je suis née minorité. Je suis née femme. Cela aura pris presque un quart de siècle, mais je crois que je commence tout juste à comprendre ce qu’être une femme implique. Le poids que je porte sur mes épaules, les embuches sur mon chemin, aussi francophone et occidentale que je sois. Je commence à comprendre ce qu’on attend de moi, si peu. J’apprends surtout ce dont je suis capable, ce que je souhaite accomplir, ce que j’aimerais devenir. J’étudie, je lis, j’écris, je réfléchis. Je prends conscience, je décide, je vise (les étoiles). Billet rédigé lors d'une retraite Thèsez-vous? par Marion Malique, étudiante à la maitrise en langue et littérature française, option recherche-création, Université McGill.
0 Commentaires
Votre commentaire sera affiché après son approbation.
Laisser un réponse. |
Envie de contribuer au blogue ?N'hésitez pas à nous contacter, ainsi qu'à nous soumettre vos idées sur les enjeux de la rédaction et de la vie académique! Archives
Septembre 2023
Thèmes
Tous
|
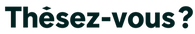

 Flux RSS
Flux RSS