 Il faut le reconnaitre, certains projets de recherche sont plus « finançables » que d’autres, du moins pour certains concours qui privilégient les démonstrations d’utilité à court terme, les impacts concrets et les énoncés claires vis-à-vis du « à quoi ça sert? ». À première vue, certaines candidatures plaisent davantage, au détriment de projets de recherche fondamentale, de recherche-création et tout autre démarche nichée qui sont plus ardues à défendre. Les dernières années passées à déposer des demandes ici, ailleurs, tout le temps et avec acharnement, m’ont toutefois permis de constater que la "forme" jouait pour beaucoup et pouvait permettre le financement de candidatures et de projets particulièrement hors normes. Comme si le savoir, savoir-être et savoir-faire ne suffisaient pas : encore fallait-il savoir-dire! Dans les cours, les ateliers et l'École d'été Thèsez-vous, je partage des éléments clés pour préparer une candidature, dont voici quelques exemples :
Bien qu’elles puissent paraitre évidentes, ce sont des recommandations à ne pas sous-estimer. Il faut cependant aller au-delà de ces "classiques" et réaliser une lecture active du programme de bourses afin de s'approprier et de couvrir l’ensemble des critères d'évaluation. Dans de cadre, j'ai développé différents outils, dont un document qui soutient ce travail de lecture active et d'appropriation tout en clarifiant les tâches à réaliser quand on se lance dans la rédaction d'une demande de bourse d'excellence. Il s’agit d’un simple tableau, à compléter dans Word, Excel ou au crayon. L’idée est de l’avoir sous la main, dès l'analyse du descriptif de la bourse, pour planifier le processus de mise en candidature. Le plus difficile est de le compléter une première fois. Ensuite, on prend l’habitude!
Attention : la première colonne du tableau final doit être modifiée en fonction des critères propres à la bourse ciblée et les autres colonnes en fonction des documents à fournir. Ensuite, il suffit de s’assurer que les cases soient complétées et que chaque critère soit couvert au minimum dans un, voire dans deux, sections de votre dossier de candidature (ex. résumé du projet, parcours intégré, lettre de motivation, lettre de recommandation). Chaque document devrait compléter les autres, plutôt que de répéter des facettes de votre candidature. Consolez-vous! Le temps et l’énergie alloués à faire une telle demande valent le coup! Ce processus permet de mieux s’approprier son objet de recherche, de réfléchir à sa pertinence scientifique et sociale, tout en offrant une occasion de discuter de son parcours avec sa direction actuelle ou future. Enfin, n’hésitez pas à communiquer avec les personnes responsables des programmes directement ou auprès de personnes ressources au sein de votre université, mais faites-le à l’avance et avec des questions précises. De plus, il ne faut jamais hésiter à soumettre pour une deuxième ou une troisième fois auprès d'un même programme, la persistance est valorisée et souvent récompensée. Bon courage et bonne rédaction! Billet rédigé par Sara Mathieu-C., Co-fondatrice de Thèsez-vous? -
Rédigé en août 2016, mis à jour en septembre 2023
0 Commentaires
Votre commentaire sera affiché après son approbation.
Laisser un réponse. |
Envie de contribuer au blogue ?N'hésitez pas à nous contacter, ainsi qu'à nous soumettre vos idées sur les enjeux de la rédaction et de la vie académique! Archives
Septembre 2023
Thèmes
Tous
|
||||||
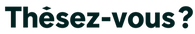
 Flux RSS
Flux RSS